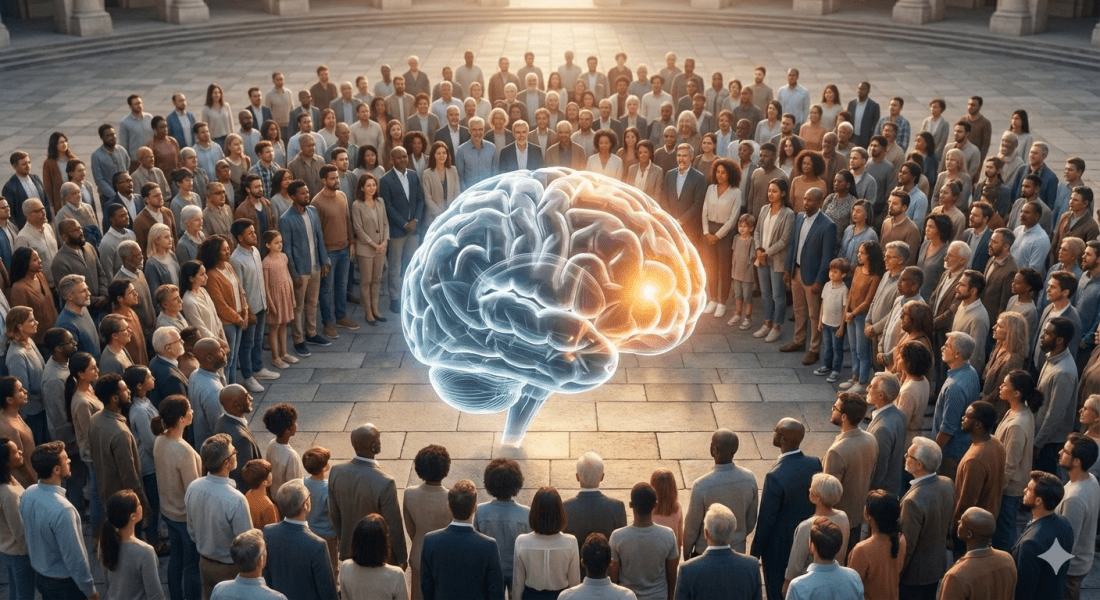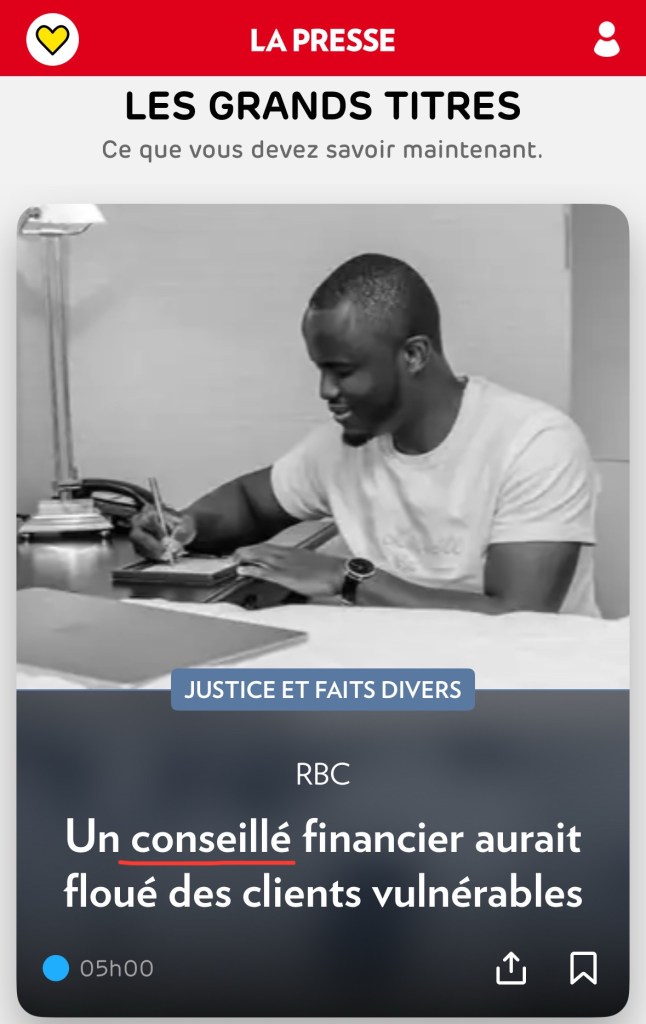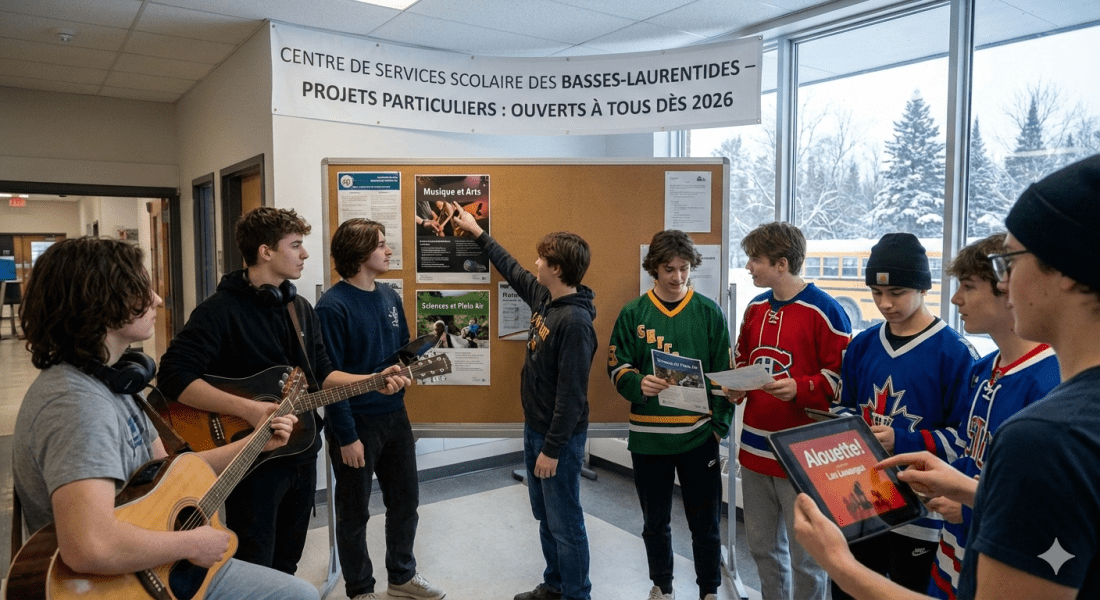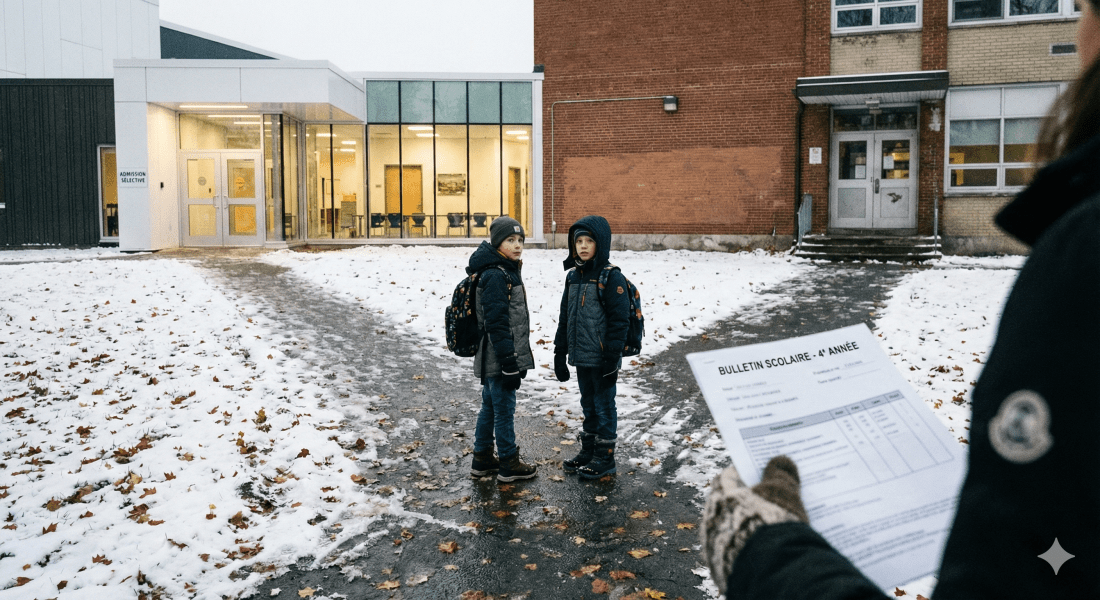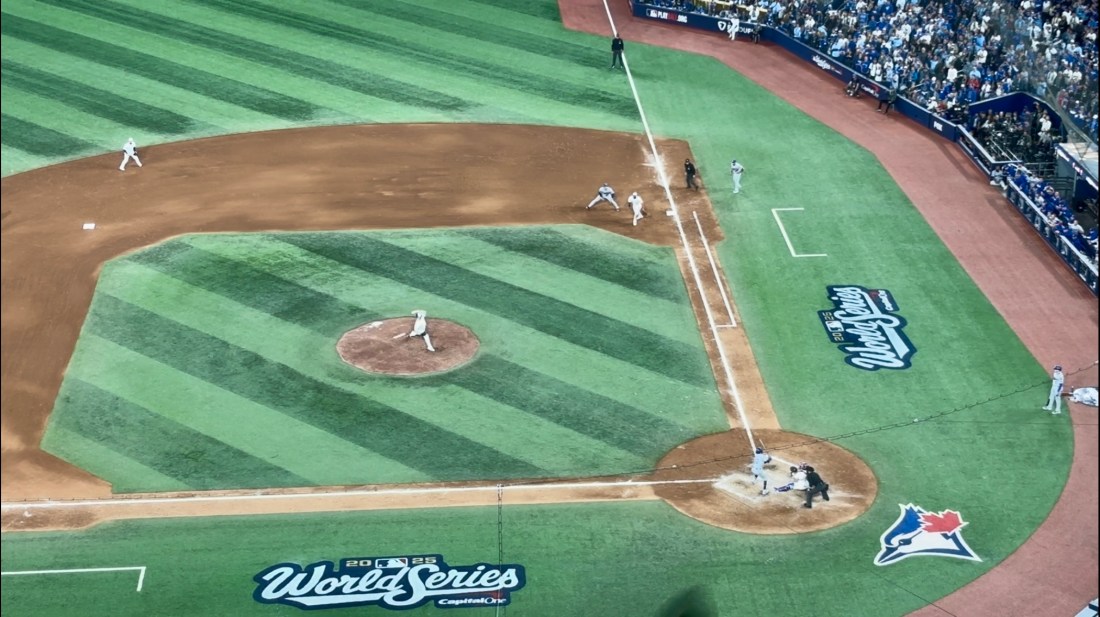Dimanche dernier, le Québec a encore avancé ses horloges. À 2 heures du matin, il était soudainement 3 heures. Une heure envolée, comme ça, au nom d’un compromis hérité d’une autre époque, qu’on continue de reconduire presque machinalement, comme s’il allait de soi. Pourtant, plus on s’intéresse sérieusement à la question, moins ce système paraît logique. Le changement d’heure ne crée aucune minute de lumière supplémentaire. Il ne fait que déplacer artificiellement la clarté dans la journée, avec tout ce que cela suppose de dérèglement pour le sommeil, les routines et l’horloge biologique. La consultation menée par le gouvernement du Québec l’an dernier l’a d’ailleurs montré très clairement : une très forte majorité des répondants souhaite qu’on mette fin à ce va-et-vient deux fois par année.
Pour ma part, ma position est claire : si l’on doit enfin sortir de ce manège, ce devrait être pour adopter l’heure normale toute l’année. Et cette fois, il ne s’agit pas seulement d’une préférence personnelle. C’est aussi, de façon assez nette, la position qui se dégage de la science du sommeil et de la chronobiologie. La Société canadienne du sommeil recommande l’abandon de l’heure avancée au profit de l’heure normale permanente. La Société canadienne de chronobiologie dit la même chose. L’American Academy of Sleep Medicine aussi. Leur raisonnement est simple : l’heure normale s’aligne mieux sur la lumière du matin, celle qui règle le plus efficacement notre horloge interne. À l’inverse, l’heure avancée repousse artificiellement le lever du jour, favorise les réveils dans la noirceur, retarde le coucher et accentue ce que les chercheurs appellent le décalage horaire social. Bref, ce n’est pas seulement une question de confort ou de goût, c’est aussi une question de santé publique.
Et c’est ici qu’un détail apparemment banal m’agace particulièrement. Dans l’espace public, on parle sans cesse de « l’heure d’été » plutôt que de l’heure avancée. Je trouve ça insidieux. Je trouve aussi que, dans une consultation populaire, ce n’est pas anodin. Le simple fait d’associer une option à l’été lui donne déjà un préjugé favorable. L’été évoque les vacances, les terrasses, les longues soirées, la chaleur, le plaisir. L’expression porte déjà sa petite campagne publicitaire en elle. L’heure avancée, elle, est une formule beaucoup plus honnête. Elle dit ce qu’elle est : une heure déplacée vers l’avant. Quand on consulte la population sur un enjeu qui touche à la santé, au sommeil et au rapport au temps, les mots devraient éclairer le débat, pas l’influencer. Et si l’on veut vraiment trancher avec sérieux, il faudrait peut-être commencer par nommer correctement les choses. La consultation québécoise a montré qu’une majorité des répondants favorables à l’abolition préféraient conserver ce qui y est appelé « l’heure d’été » à l’année. Cela rend, à mes yeux, le choix des mots encore plus important.
Ce décalage n’affecte pas tout le monde de la même manière. Les enfants, et plus encore les adolescents, sont particulièrement sensibles à ces réveils dans la noirceur et à cette dette de sommeil qui se répercute ensuite jusque dans les classes, là où on leur demande d’être attentifs, disponibles et prêts à apprendre dès les premières heures du jour. À force de vouloir gagner un peu de lumière le soir, on finit surtout par décaler inutilement notre horloge biologique.
Sources :
- Gouvernement du Québec, « Une majorité de Québécois voudrait mettre fin au changement d’heure », 8 mars 2025.
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/une-majorite-de-quebecois-voudrait-mettre-fin-au-changement-dheure-61465 - Société canadienne du sommeil, « Position statement of the Canadian Sleep Society on the practice of daylight saving time (DST) », 7 mars 2023.
https://css-scs.ca/society-news/position-statement-of-the-canadian-sleep-society-on-the-practice-of-daylight-saving-time-dst/ - Jean De Koninck, Annie Nixon et Roger Godbout, The practice of Daylight Saving Time in Canada: Review of the scientific literature and its suitability with regards to sleep and circadian rhythms, rapport soumis à la Société canadienne du sommeil, 15 juin 2022.
https://css-scs.ca/wp-content/uploads/2022/09/CSS-DST-Report-June-15-2022.pdf - Société canadienne de chronobiologie, « Déclaration officielle de la Société canadienne de chronobiologie en appui à l’heure normale à l’année longue », 13 avril 2022.
https://www.chronobiocanada.com/declaration-officielle - M. A. Rishi et al., « Permanent standard time is the optimal choice for health and safety: an American Academy of Sleep Medicine position statement », Journal of Clinical Sleep Medicine, vol. 20, no 1, 2024, p. 121-125.
https://jcsm.aasm.org/doi/pdf/10.5664/jcsm.10898 - American Academy of Sleep Medicine, « Permanent standard time is the optimal choice for health and safety ».
https://aasm.org/advocacy/position-statements/permanent-standard-time-is-the-optimal-choice-for-health-and-safety/
Dans mes écouteurs
Suivons le courant ! Voici Angine de Poitrine, avec la pièce Fabienk. Est-ce que j’aime vraiment leur musique ? Oui, absolument ! Et le phénomène sait me divertir.
La bonne nouvelle de cette semaine
À Montréal, il arrive parfois qu’une bonne nouvelle fasse plus que remonter le moral : elle élargit l’horizon. Cette semaine, elle nous vient du CHU Sainte-Justine, où une équipe dirigée par le Dr Élie Haddad a franchi un cap qui ressemble à un petit basculement dans l’histoire de la médecine. Un jeune patient traité l’an dernier pour une maladie génétique rare du système immunitaire, la granulomatose chronique, peut aujourd’hui être considéré comme essentiellement guéri. Un an plus tard, il ne présente plus de symptômes, mène une vie normale, et la thérapie utilisée, fondée sur une correction très précise de la mutation génétique en cause, ouvre une voie qui semblait encore récemment relever du rêve.
Ce que j’aime dans cette nouvelle, au-delà de l’exploit scientifique, c’est ce qu’elle dit de nous. Elle dit qu’ici aussi, au Québec, dans un hôpital pour enfants de Montréal, on peut faire avancer le monde. Elle dit que la recherche n’est pas qu’une affaire de laboratoires lointains et de jargon inaccessible, mais aussi une promesse tenue, un jeune de 18 ans qui respire enfin plus librement, une famille qui retrouve de l’espace pour vivre, et une équipe qui entrouvre la porte pour tant d’autres. Quand la science cesse de vendre du rêve pour commencer à livrer du réel, il y a de quoi regarder la suite avec confiance. Et celle-ci donne envie d’y croire encore davantage.
Source :
Legault, J.-B. (2026, 7 mars). World’s first possible ‘cure’ of chronic granulomatous disease at Montreal’s CHU Sainte-Justine. CityNews Montreal. https://montreal.citynews.ca/2026/03/07/worlds-first-cure-chronic-granulomatous-disease-montreal/